Dire oui à des électrodes dans le cerveau
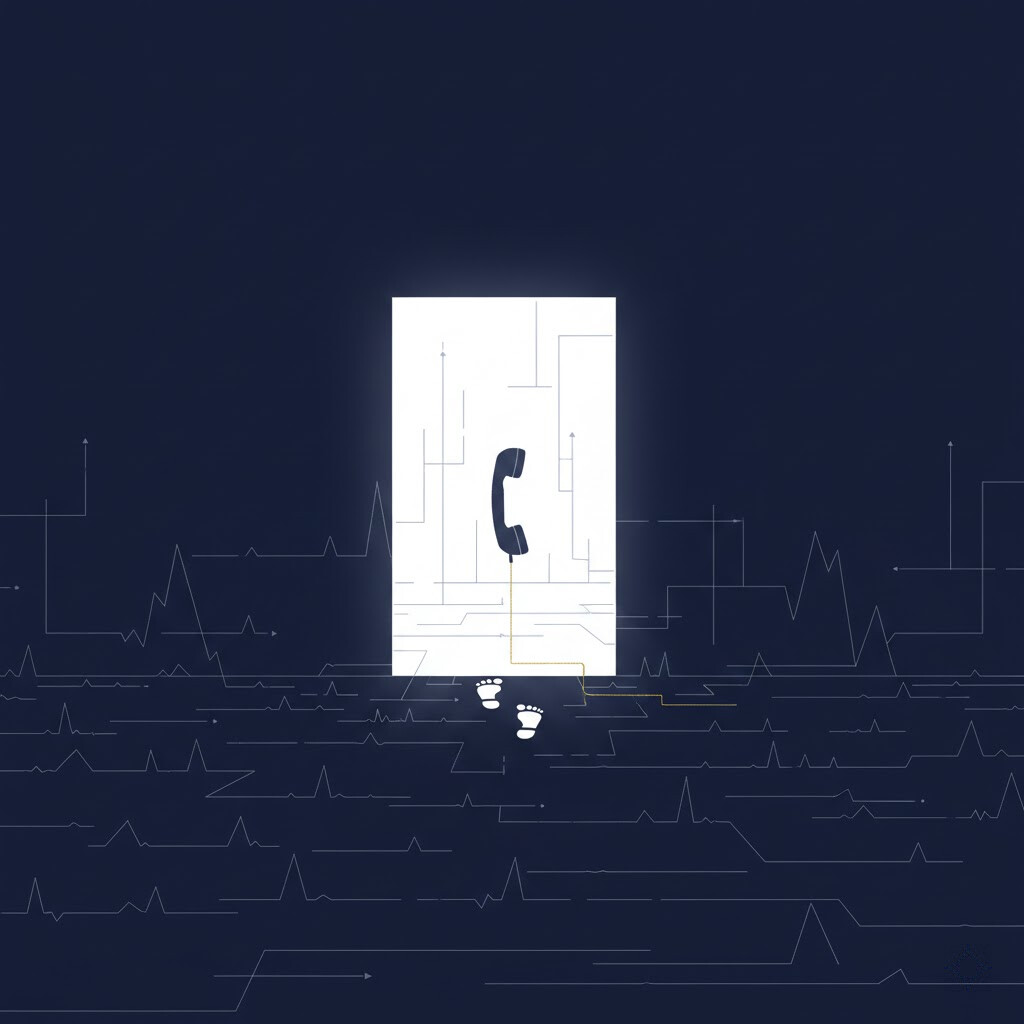
Dans les billets précédents, j'ai raconté la maladie, ce qui dysfonctionne, et comment on construit une vie malgré tout. Ce billet-ci parle du moment où on se pose la question suivante : est-ce qu'on accepte qu'on vous ouvre le crâne pour implanter des électrodes dans le cerveau ?
Ce n'est pas une question qu'on prend à la légère. Et le chemin pour y répondre a été long, chaotique, et parfois brutal.
Le point de départ : savoir que ça existe
La stimulation cérébrale profonde, j'en avais entendu parler depuis des années. Mon neurologue m'en avait parlé, j'avais lu des choses, je savais que c'était une option théorique pour la DYT11. Mais entre savoir qu'une opération existe et envisager concrètement de la subir, il y a un gouffre. Un gouffre fait de peur, de méconnaissance, et de ce réflexe très humain qui consiste à repousser une décision difficile tant qu'on peut encore vivre sans.
En 2023-2024, j'ai décidé de franchir le pas de la consultation. Pas encore de l'opération, juste de la consultation. Aller voir des neurochirurgiens, comprendre ce que c'est vraiment qu'une DBS, poser des questions, évaluer les risques, mesurer les bénéfices possibles. Voir si c'était pour moi.
J'ai consulté trois équipes : Montpellier, Bordeaux, et Paris, à la Pitié-Salpêtrière.
Montpellier : le moral dans les chaussettes
La première consultation, c'était Montpellier. Et je vais être honnête : elle m'a miné le moral.
Le spécialiste que j'ai rencontré était aussi sympathique qu'une porte de prison. Je suis quelqu'un d'anxieux de tempérament, je venais pour la première fois de ma vie me renseigner sur une opération du cerveau, et je ne connaissais rien de concret à la DBS. J'avais besoin qu'on m'explique, qu'on me rassure un minimum, qu'on prenne le temps de répondre à des questions que je savais maladroites mais qui étaient les miennes.
Ce que j'ai eu à la place, c'est un spécialiste qui m'a dit, en substance, que j'étais stupide de ne pas m'être fait opérer plus tôt.
On ne dit pas ça à quelqu'un. On ne dit pas ça à un patient qui découvre un univers médical qu'il ne maîtrise pas, qui est anxieux, qui fait l'effort de venir consulter alors qu'il aurait pu continuer à repousser la décision indéfiniment. Ce genre de phrase n'informe pas, ne motive pas, ne rassure pas. Elle écrase. Elle culpabilise. Elle donne envie de rentrer chez soi et de ne plus jamais en reparler.
Je suis reparti de Montpellier avec le moral plus bas qu'en arrivant, et une conviction renforcée que le monde médical a un problème sérieux avec la manière dont il s'adresse aux patients.
La Pitié-Salpêtrière : la remise à zéro
Et puis il y a eu Paris. La Pitié-Salpêtrière.
L'équipe de neurochirurgie fonctionnelle m'a remis à zéro. Pas dans le sens où tout est devenu simple ou que mes peurs ont disparu d'un coup, mais dans le sens où, pour la première fois, j'ai eu le sentiment d'être face à des gens qui savaient exactement de quoi ils parlaient et qui prenaient le temps de l'expliquer.
Et au centre de cette équipe, il y a une personne qu'il faut nommer : la Professeure Carine Karachi. Fantastique. Il n'y a pas d'autre mot. Compétente, claire, humaine, capable d'expliquer une opération du cerveau de manière à ce que vous compreniez ce qui va se passer sans vous noyer dans le jargon et sans vous prendre de haut. Quelqu'un qui vous parle comme à un adulte capable de décider pour lui-même, et qui prend le temps de répondre aux questions, y compris celles que vous trouvez vous-même idiotes. Dans un parcours médical où l'on passe beaucoup de temps à se sentir comme un dossier parmi d'autres, croiser un médecin de cette trempe fait une différence immense.
La Pitié m'a donné confiance. Confiance dans le fait que cette opération était sérieuse, encadrée, réfléchie. Confiance dans le fait que l'indication serait posée rigoureusement, que je ne serais pas poussé vers le bloc si les conditions n'étaient pas réunies. Confiance dans le processus. La Pitié-Salpêtrière m'a redonné ce que Montpellier m'avait pris : l'envie de continuer à avancer vers une décision.
Bordeaux : une formalité
J'ai aussi consulté à Bordeaux. Mais pour être honnête, quand j'y suis allé, mon choix était déjà fait. La Pitié-Salpêtrière avait posé les bases, la confiance était là, l'équipe était identifiée. Bordeaux a été une étape, pas un tournant. Je ne dis pas que l'équipe n'était pas compétente, je dis simplement que quand on a trouvé l'endroit et les gens avec qui on veut faire ce chemin, on le sait, et le reste devient une confirmation plutôt qu'une découverte.
Retour à Paris, donc, pour les examens de pré-réalisation. Le vrai compte à rebours commençait.
Retour à la Pitié : le bilan d'opérabilité
Mais il faut que je parle de ce qui a été moins brillant, parce que le bilan d'opérabilité est un parcours en soi, et il peut être éprouvant pour des raisons qui n'ont rien de médical.
Quand on vous évalue pour savoir si vous êtes opérable, vous passez une batterie de tests neuropsychologiques. C'est normal, c'est nécessaire, personne ne conteste le principe. Ce que je conteste, c'est la manière dont certaines personnes chargées de faire passer ces tests se comportent avec les patients. Quand vous êtes atteint d'une dystonie myoclonique sévère, que vous venez pour une évaluation qui va potentiellement déboucher sur une opération du cerveau, et que vous êtes anxieux par nature, la moindre des choses serait d'être traité avec un minimum de respect et de considération.
Ce que j'ai eu à la place, dans certains cas, ce sont des comportements inacceptables. On m'a infantilisé, comme si le fait d'avoir un handicap moteur impliquait un handicap intellectuel. On m'a traité de manière condescendante. On m'a forcé à écrire à la main alors que j'avais expliqué que c'était impossible, comme si le fait de l'expliquer calmement n'était pas suffisant et qu'il fallait vérifier par soi-même que le patient ne mentait pas. On m'a piqué avec une épingle sans prévenir, comme on testerait les réflexes d'un cobaye et non d'un être humain.
Je pourrais continuer la liste. Je m'arrête là parce que le billet n'est pas un procès, mais le message est le suivant : il y a dans les hôpitaux, y compris les meilleurs, des personnes qui n'ont pas compris que leur rôle n'est pas seulement de faire passer un test, mais de le faire passer à un être humain. Et quand cet être humain est déjà fragilisé par la maladie, l'anxiété et l'enjeu de ce qui se joue, le minimum serait de ne pas en rajouter.
Cela ne change rien au bilan global : la Pitié-Salpêtrière reste l'endroit où je me suis fait opérer, et je referais ce choix sans hésiter. Mais ce parcours aurait été moins douloureux si certaines personnes avaient fait leur travail avec un peu plus d'humanité.
Les coups de téléphone qui ont tout changé
Pourtant, ce n'est ni Montpellier, ni Bordeaux, ni même la Pitié-Salpêtrière qui m'ont fait franchir le pas. Ce qui m'a fait dire oui, ce sont des coups de téléphone.
Des coups de téléphone avec d'autres patients, déjà implantés, qui vivaient avec une DBS depuis des mois ou des années.
Les médecins peuvent vous expliquer les statistiques, les taux de succès, les risques opératoires, les mécanismes neurophysiologiques. C'est indispensable, c'est leur rôle, et il faut ces informations pour prendre une décision éclairée. Mais il y a quelque chose que les médecins ne peuvent pas vous donner : le vécu. Ce que ça fait au quotidien. Comment on se sent le matin en se réveillant avec un boîtier sous la peau. Si les gestes reviennent vraiment. Si la vie change concrètement ou si c'est surtout sur le papier.
Ces réponses-là, seuls d'autres patients peuvent les donner. Et quand quelqu'un qui vit avec les mêmes électrodes, dans le même corps dystonique que le vôtre, vous dit au téléphone que ça a changé sa vie, que les gestes sont revenus, que les myoclonies se sont calmées, que c'était difficile mais que c'était la bonne décision, ça a un poids que aucun article scientifique ne pourra jamais atteindre.
C'est là, au téléphone, dans des conversations avec des inconnus qui partageaient la même maladie et le même choix, que j'ai compris que je pouvais y aller. Pas que je devais, mais que je pouvais. Que le risque valait la peine d'être pris. Que l'élastique, même abîmé, méritait qu'on saute.
Ce que je retiens de cette période
La décision de se faire opérer du cerveau ne se prend pas dans un cabinet médical. Elle se prend en soi, au terme d'un processus lent, fait de consultations, de recherches, de nuits blanches, de conversations, et d'un moment où quelque chose bascule. Ce moment est différent pour chacun. Pour moi, c'est venu par la voix d'autres patients au bout du fil.
Si vous êtes atteint de DYT11 et que vous vous posez la question de la DBS, mon conseil le plus important n'est pas médical. Il est humain : parlez à des gens qui l'ont fait. Demandez à votre équipe de vous mettre en contact avec d'autres patients. Posez-leur les questions que vous n'osez pas poser aux médecins. Écoutez ce qu'ils ont à dire, le bon comme le moins bon, et faites-vous votre propre avis.
Et si vous n'avez personne à appeler, appelez-moi.
Je ne suis pas médecin, je ne donnerai pas d'avis médical, ce n'est pas mon rôle. Mais je suis passé par là, je sais ce que c'est que d'avoir peur, de ne pas comprendre, de se sentir seul face à une décision immense, et de tomber sur des gens qui vous enfoncent au lieu de vous aider. Dans mon parcours, les gens qui ont réellement répondu à mes questions se comptent sur les doigts d'une main. Certains invoquent le principe du « vous n'avez pas à savoir ». D'autres vous estiment trop stupide pour comprendre. Dans mon cas, seules une neurochirurgienne, une neurologue et une interne ont pu me répondre. Je veux expliquer, rassurer, accompagner, répondre aux questions que trop peu de gens prennent le temps d'écouter. Je veux donner ce que j'ai si peu reçu. C'est aussi simple que ça.
Le prochain billet racontera l'opération elle-même.
À suivre.
