Un an, et un cerveau augmenté
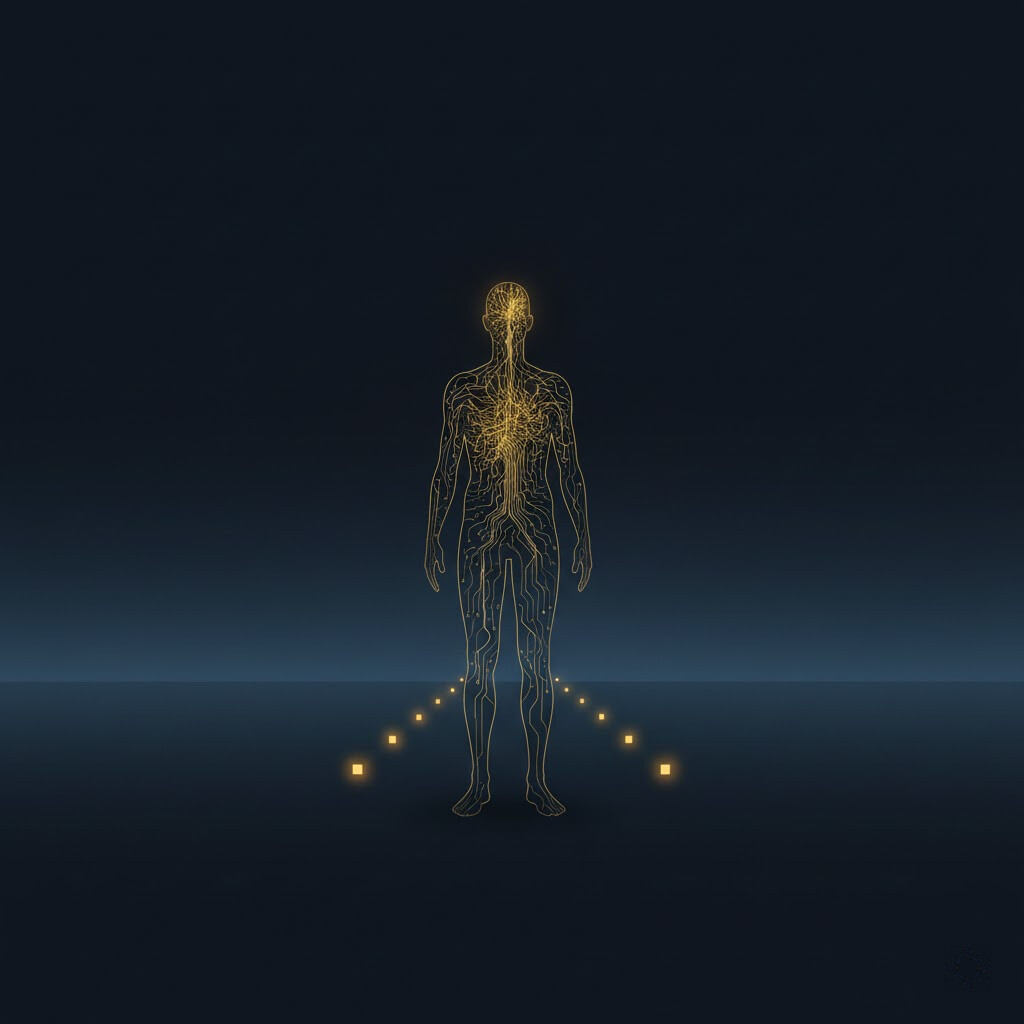
Nous sommes début février 2026. Il y a un an, presque jour pour jour, j'étais sur une table d'opération à la Pitié-Salpêtrière, avec une équipe de neurochirurgiens dans mon crâne et mes parents dans un couloir. Aujourd'hui, j'écris ces lignes avec des électrodes dans le cerveau, un boîtier sous la peau, un câble qui relie les deux, et une vie qui ne ressemble plus tout à fait à celle d'avant.
Ce billet n'est pas un bilan définitif. C'est trop tôt pour ça. C'est une photo prise à un instant T, avec du positif, du négatif, et beaucoup de choses que je n'ai pas encore fini de comprendre.
Je suis un cyborg
Autant commencer par là, parce que c'est vrai, et que ça me fait sourire chaque fois que j'y pense. J'ai du métal dans le crâne, un générateur d'impulsions électriques sous la peau du thorax, et un câble qui passe sous la peau du cou pour relier l'ensemble. Mon cerveau reçoit en permanence un signal électrique artificiel qui modifie son fonctionnement. Par définition, je suis un cyborg. Un vrai.
Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas une métaphore. C'est mon mardi matin. Je me réveille, je prends mon petit-déjeuner, et pendant ce temps-là, un dispositif médical envoie du courant dans mon globus pallidus interne pour que mes muscles arrêtent de faire n'importe quoi. Si ça, ce n'est pas être un cyborg, je ne sais pas ce que c'est.
Il y a quelque chose de profondément étrange et profondément banal dans cette réalité. Étrange parce que l'idée même reste vertigineuse quand on y pense trop longtemps. Banal parce qu'au quotidien, ça devient juste ta vie. Le boîtier fait partie de toi, les électrodes font partie de toi, et le courant qui traverse ton cerveau fait partie de toi. Le cyborg, c'est moi, et moi, c'est le cyborg.
Le boîtier
Un an après, le boîtier est toujours là. Évidemment, il est toujours là, il n'allait pas partir tout seul. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le sent. La cicatrice sur le thorax s'est atténuée, elle ne tire plus comme dans les premières semaines, mais le boîtier lui-même reste perceptible sous la peau. Quand tu passes la main dessus, tu sens un rectangle dur, un objet qui n'a pas sa place dans un corps humain et qui est pourtant devenu une pièce essentielle de ta machinerie.
Et puis il y a la recharge. Le boîtier est rechargeable, ce qui signifie que régulièrement, il faut poser un chargeur magnétique sur le thorax et attendre que la batterie se remplisse. C'est un petit rituel qui s'installe dans la vie, comme charger son téléphone, sauf que le téléphone en question est à l'intérieur de ton corps et que s'il se décharge complètement, ce ne sont pas tes emails qui s'arrêtent, c'est ta stimulation cérébrale. Ça met les choses en perspective.
On s'y habitue. On intègre la recharge dans sa routine, on surveille le niveau de batterie, on apprend à anticiper. Mais il y a toujours ce petit moment, quand on pose le chargeur sur sa poitrine, où l'on se rappelle que son cerveau fonctionne grâce à un appareil qui a besoin d'être branché.
Le câble
Le câble a été la surprise désagréable de la première année. Ce fil qui passe sous la peau du crâne, descend derrière l'oreille, longe le cou et rejoint le boîtier dans la poitrine. Dans les premiers mois, il était hypersensible, chaque mouvement de tête le rappelait à mon attention. Un an plus tard, c'est mieux. Pas parfait, mieux. Il y a encore des jours où il tire, des positions qui le réveillent, des moments où tu sens cette présence étrangère sous la peau qui te rappelle qu'il y a du câblage là-dessous. Mais la plupart du temps, il se fait oublier. Le corps a fini par admettre, sinon accepter, qu'il y a un locataire dans le cou.
Les gestes
Les gestes retrouvés dont je parlais dans le billet précédent sont toujours là. Ils sont même devenus normaux, ce qui est peut-être la plus belle victoire. Je ne pense plus au fait que je me brosse les dents d'une seule main. Je le fais, c'est tout. Je ne me félicite plus de verser de l'eau sans renverser. Je verse, c'est tout. La normalité est redevenue normale, et c'est extraordinaire précisément parce que ça ne l'est plus.
Mais il y a aussi des gestes nouveaux qui apparaissent, des petites choses que je découvre pouvoir faire et que je n'avais même pas identifiées comme impossibles avant, tellement elles faisaient partie du paysage de la maladie. Le corps continue de se recalibrer, un an après, et il y a encore des surprises. Des bonnes.
Il reste aussi des limites. La stimulation n'a pas tout effacé, et c'est important de le dire. Les myoclonies sont atténuées, pas éliminées. La dystonie est réduite, pas abolie. Il y a encore des jours moins bons, des moments où le corps rappelle qu'il est câblé précisément parce qu'il ne fonctionne pas comme il devrait. La DBS n'est pas une guérison. C'est un outil, puissant, transformateur, mais un outil.
Expliquer la DBS
Il y a un aspect de la vie avec une DBS auquel on ne pense pas avant de l'avoir : l'expliquer aux autres. Parce que ça se voit un peu (la cicatrice sur le crâne, le boîtier qu'on devine parfois sous un t-shirt), et surtout parce que les gens posent des questions. Ou ne les posent pas.
C'est ça le plus frappant : les gens sont polarisés. Il y a ceux qui ont peur, qui changent de sujet, qui détournent le regard de la cicatrice, qui ne veulent pas savoir parce que l'idée même d'avoir des électrodes dans le cerveau les terrifie. Et il y a ceux qui se taisent, qui n'osent pas demander, qui marchent sur des œufs parce qu'ils ne savent pas si c'est un sujet qu'on peut aborder.
Moi, j'adore expliquer. J'adore raconter comment ça marche, pourquoi c'est là, ce que ça fait, ce que ça ne fait pas. J'adore voir les yeux s'écarquiller quand je dis qu'il y a du courant qui traverse mon cerveau en permanence, et j'adore encore plus le moment où la personne en face comprend que c'est fascinant plutôt qu'effrayant. La DBS n'est pas un sujet tabou pour moi, c'est un sujet passionnant, et je ne me lasserai jamais d'en parler. Alors posez vos questions. Toutes vos questions. Les naïves, les techniques, les bizarres. Je préfère mille fois quelqu'un qui demande "mais ça fait pas mal ?" à quelqu'un qui change de trottoir.
Ce qui change dans la vie (et ce à quoi on ne pense pas)
Avoir une DBS, ce n'est pas seulement un bénéfice moteur et un boîtier à recharger. C'est aussi une série de contraintes pratiques que personne n'imagine avant de les vivre.
Plus d'IRM. Sauf protocole très spécifique et très encadré, l'imagerie par résonance magnétique est interdite. Le champ magnétique et les électrodes dans le cerveau ne font pas bon ménage. Ce qui signifie que si un jour j'ai besoin d'un diagnostic qui nécessite une IRM, il faudra trouver une alternative. On n'y pense pas au quotidien, jusqu'au jour où on en a besoin.
Les portiques des aéroports. C'est dangereux de passer sous les portiques de sécurité. À chaque fois. J'ai une carte qui explique que j'ai un dispositif médical implanté, et en général ça se passe bien, mais il y a toujours ce petit moment où tu tends ta carte à l'agent de sécurité et où tu te demandes s'il va comprendre ou si tu vas finir dans une salle à part pour expliquer que non, tu ne transportes pas de métal suspect, c'est juste ton cerveau qui est câblé.
La tête. Faire attention à ne pas avoir d'accidents à la tête. Déjà de base, on n'est pas idiot, on ne se cogne pas le crâne pour le plaisir. Mais quand il y a des électrodes à l'intérieur, la prudence prend une autre dimension. Un choc violent pourrait déplacer une électrode, endommager le dispositif, créer un problème qui n'existait pas. On y pense dans les situations stupidement banales : une porte d'armoire restée ouverte, un passage trop bas, un mouvement brusque. On développe une vigilance du crâne qu'on n'avait pas avant.
Et puis il y a la conscience permanente d'avoir dans le corps quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Le boîtier fonctionne, les électrodes stimulent, et tout ça se passe sans que tu aies ton mot à dire. Tu ne contrôles pas le courant, tu ne sens pas les impulsions, tu ne sais pas exactement ce qui se passe à l'intérieur de ton propre cerveau à chaque instant. C'est un acte de confiance continu, une délégation permanente à une machine. La plupart du temps, on n'y pense pas. Et puis il y a des moments, tard le soir, dans le silence, où tu te rappelles que ton cerveau fonctionne grâce à un appareil, et c'est vertigineux.
Les réveils nocturnes
Il faut que je parle de ça aussi, parce que ce serait malhonnête de ne pas le faire.
Il y a six ans, bien avant que la DBS soit une option concrète, j'avais fait un cauchemar. Un de ceux qui restent. J'avais rêvé qu'on m'enlevait le cerveau pour le remplacer par des électrodes, des espèces de filaments d'ampoule à incandescence qui prenaient toute la place dans mon crâne. Je m'étais réveillé en sueur, le cœur qui tapait, avec la certitude viscérale que quelqu'un avait trafiqué l'intérieur de ma tête.
Six ans plus tard, il y a effectivement des électrodes dans ma tête. Le cauchemar est devenu la réalité, sauf que la réalité est thérapeutique et que le cauchemar ne l'était pas. Mais le cerveau, lui, ne fait pas toujours la distinction.
Ça m'arrive de me réveiller la nuit et de me dire : "MAIS J'AI DES ÉLECTRODES DANS LA TÊTE." Comme ça, d'un coup, sans prévenir. Tu dormais tranquillement, et puis une partie de ton cerveau décide de te rappeler à trois heures du matin que l'autre partie de ton cerveau est câblée. C'est une attaque de panique en miniature, un sursaut de conscience qui te secoue et qui met quelques minutes à se dissiper. Tu te rationalises, tu te calmes, tu te rappelles que tout va bien, que c'est normal, que c'est là pour t'aider. Et puis tu te rendors. Jusqu'à la prochaine fois.
Et puis il y a la crainte que les électrodes tombent. Je sais. C'est ridicule. Elles sont fixées, vissées, implantées, elles ne vont nulle part. Elles ne vont pas glisser hors du cerveau comme un bouchon mal enfoncé. Mais la peur irrationnelle n'a pas besoin de logique pour exister, et il m'est arrivé, dans un demi-sommeil, de me demander si les électrodes étaient toujours en place, comme on vérifie machinalement que ses clés sont dans sa poche. Sauf que là, tu ne peux pas vérifier. Tu fais confiance. Encore et toujours, tu fais confiance.
Réapprendre à se connaître
C'est peut-être la partie la plus inattendue de toute cette aventure. Un an après l'opération, je ne suis plus tout à fait la même personne, et je ne parle pas seulement du plan moteur.
Pendant trente-cinq ans, je me suis construit avec la maladie. Mes stratégies, mes compensations, mes limites, mes reflexes, ma façon d'aborder le monde, tout ça s'est bâti autour d'un corps qui dysfonctionnait. Et maintenant que le corps fonctionne différemment, toute cette architecture intérieure doit être révisée.
On me pose parfois la question : "Et si un jour tu voulais le retirer ?" La réponse est simple : pourquoi ? J'ai abordé cette opération un peu comme mon handicap : c'est irréversible, et c'est très bien comme ça. Mon handicap, je ne l'ai pas choisi, mais je l'ai intégré, j'ai construit avec, il fait partie de moi. La DBS, je l'ai choisie, et elle fait partie de moi aussi. Techniquement, on pourrait retirer les électrodes. Mais pourquoi faire ? Ce serait comme demander à quelqu'un qui voit enfin correctement s'il veut qu'on lui retire ses lunettes. Non merci.
Et puis il faut être honnête sur le plan médical : retirer les électrodes n'est pas anodin. Avec le temps, une fibrose se forme autour des électrodes implantées dans le cerveau, du tissu cicatriciel qui englobe le matériel. Les retirer, c'est arracher quelque chose que le cerveau a intégré dans sa structure, avec tous les risques que ça comporte. Ce n'est pas comme débrancher une prise. C'est potentiellement dangereux. Une raison de plus pour ne pas y penser, et une raison de plus pour être en paix avec le caractère définitif de la chose.
Et c'est là que je veux insister, parce que c'est peut-être la chose la plus importante que j'ai comprise dans toute cette histoire. Dans ma vie, entre mon handicap et ma DBS, j'ai été face deux fois à quelque chose qu'on ne peut pas vraiment choisir. On peut juste intégrer. Le handicap, je ne l'ai pas choisi, il est arrivé, il était là, il fallait faire avec. La DBS, je l'ai choisie, mais une fois que c'est fait, c'est fait, et le choix n'existe plus. Dans les deux cas, il n'y a qu'une seule direction possible : vers l'avant.
Donc, ben, j'intègre.
"Est-ce que tu as fait le bon choix ?" "Est-ce que tu gères bien ton handicap ?" Ce sont des non-questions. Des considérations d'élastique pété. Et contrairement à des questions de philosophie, d'éthique, de métaphysique, on ne peut pas réfléchir dessus. On ne peut que les vivre. L'élastique est coupé, tu es en bas du pont, c'est fini, on ne remonte pas. J'ai fait, je gère, j'ai eu le choix, je l'ai pris, je ne l'ai plus, et au moins c'est fait. Je n'aurais pas pu faire plus d'efforts. Personne ne peut demander plus que ça à qui que ce soit. Et certainement pas à quelqu'un qui a accepté qu'on lui perce le crâne pour planter des électrodes dans le cerveau.
Mais la question touche à quelque chose de plus profond : l'identité. Qui suis-je, maintenant ? Le même homme avec un outil en plus ? Quelqu'un de nouveau ? Un mélange des deux ? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, et c'est peut-être normal. Ce que je sais, c'est que les limites ont bougé, que les impossibilités sont devenues des possibilités, que les gestes que j'avais rayés de ma vie sont revenus, et qu'il faut réapprivoiser tout ça. Redéfinir ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, et surtout ce que je veux faire maintenant que les cartes ont été redistribuées.
Je suis en plein dedans. Je réapprends mes limites, et elles ne sont plus les mêmes. C'est vertigineux et c'est grisant, et je n'ai pas encore fini de comprendre où elles se trouvent. Il faut du temps pour habiter un corps qui a changé de règles, même quand le changement est pour le mieux.
Trop tôt pour conclure
Je ne ferai pas de bilan définitif. Pas aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de positif que de négatif, ça je peux le dire. La DBS a transformé mon quotidien de manière concrète et mesurable. Mais un an, c'est court. Le cerveau est encore en train de s'adapter, les réglages peuvent encore évoluer, et moi-même je suis encore en train de comprendre ce que cette opération a changé, au-delà des gestes et des symptômes.
Ce que je sais, c'est ceci : je regrette. Bien sûr que je regrette. Je regrette les mauvais moments, les mois de brouillard, les nausées, les vertiges, les nuits où je me réveillais en panique avec la certitude absurde que les électrodes allaient tomber, les tests préopératoires humiliants, le spécialiste de Montpellier, les réveils à trois heures du matin. Je regrette chaque instant de souffrance inutile. Mais maintenant, ils sont derrière moi, et ils sont passés. Et regretter quelque chose qui est passé, ça ne sert à rien. Ça ne change rien, ça n'efface rien, ça ne répare rien. Alors je les range, et j'avance.
Et avancer, ça veut dire se focaliser sur les points positifs. Parce qu'il y en a, et ils sont concrets. Je me tiens plus droit. Ça paraît rien, dit comme ça, mais quand ta dystonie t'a tordu le tronc pendant trente-cinq ans, se redresser c'est un événement. J'ai beaucoup moins de myoclonies, et celles qui restent sont amorties, gérables, supportables. Ma voix est plus posée, plus stable, moins parasitée par les secousses qui la faisaient trembler. Je peux manger en public plus facilement, sans cette concentration permanente pour ne pas renverser, sans cette tension de chaque instant pour amener la fourchette à la bouche sans incident.
Et il y a encore des progrès prévus. Les réglages continuent, le cerveau continue de s'adapter, et l'équipe médicale estime que le bénéfice peut encore s'améliorer. Un an, c'est beaucoup, mais pour la DBS dans la dystonie, c'est encore le début de l'histoire.
Est-ce que je sauterais à nouveau ? Oui. Avec appréhension, oui.
À suivre ?
